Le bouddhisme et l'islam sont les deux principales religions du Ladakh. Leh est majoritairement bouddhiste, tandis que Kargil est principalement peuplé de musulmans chiites. Il existe également une petite population de musulmans sunnites, ainsi que des hindous, des sikhs et des chrétiens ladakhis.
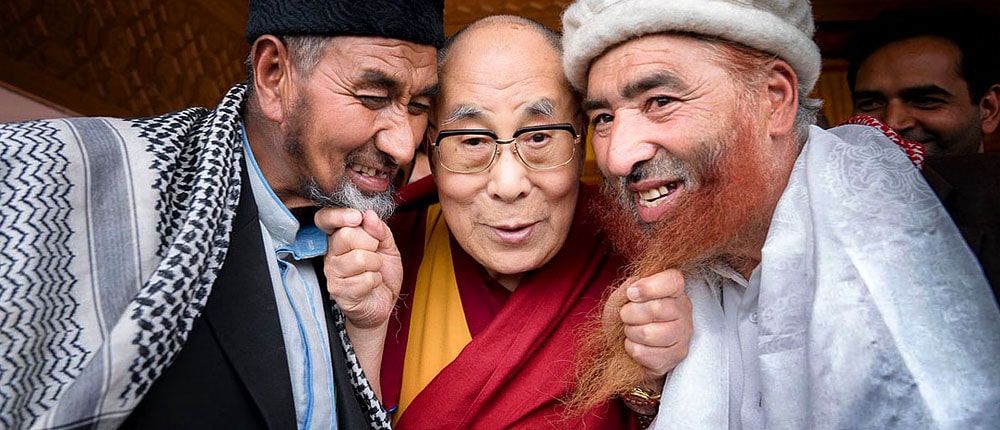
Histoire des religions au Ladakh
Culte de la nature
Les premiers habitants du Ladakh étaient des Aryens qui attribuaient un pouvoir divin à la nature et vénéraient ses nombreux aspects. Cette croyance était similaire aux religions védiques du sous-continent indien.
Chamanisme
Après la période du culte de la nature, le chamanisme ou la religion Bön s'est implanté au Ladakh. Comme le culte de la nature avant lui, il possédait un panthéon de dieux et de déesses. Au Ladakh, l’actuel monastère de Lamayuru était le siège du pouvoir de cette foi.
Premières incursions du bouddhisme
L’empereur Ashoka envoya des missionnaires au Ladakh pour convertir la population en conflit au bouddhisme, avec des résultats mitigés. Le bouddhisme ne s’est vraiment implanté au Ladakh que lorsque les Kouchans ont conquis la région aux 1er et 2e siècles après J.-C. Le symbole le plus visible de cette époque est le stupa de Kanika dans la vallée du Zanskar. Cependant, après la chute des Kouchans, le bouddhisme ne survécut pas longtemps au Ladakh.
Première expansion du bouddhisme
Lorsque le Ladakh fut intégré à l’Empire tibétain au 7e siècle, l’empereur tibétain Songtsen Gampo initia une période de diffusion du bouddhisme dans ses domaines, poursuivie par les empereurs Trisong Detsen et Tri Ralpachan. Le bouddhisme connut un âge d’or au 8e siècle, avant d’être supprimé par les politiques de l’empereur Langdarma et la chute du Tibet dans une guerre civile. Pendant ce temps, le Ladakh était dominé par des princes rivaux.
La seconde diffusion du bouddhisme
Au 11e siècle, Yeshes Od de Guge, petit-fils cadet du roi Skyid Lde Nyima du Ladakh, relança le bouddhisme au Tibet, événement connu sous le nom de "Seconde diffusion du bouddhisme". Plusieurs monastères bouddhistes furent construits au Ladakh. Ces monastères sont souvent attribués au savant Rinchen Zangpo, mais des recherches récentes suggèrent d’autres origines. Parmi eux, Alchi Choskor est mondialement connu pour ses peintures. Le monastère de Nyarma, le plus important, fut pillé et détruit par les envahisseurs turcs sous Mirza Haider au 16e siècle.
Fondation des grands monastères
Au 12e siècle, les premiers monastères majeurs furent fondés. Ils appartenaient à l’ancienne secte Kadampa et comprenaient les monastères de Likir, Thiksey et Spituk. Sous le règne du roi Lhachen Ngosdup Gon, de jeunes moines furent envoyés au Tibet pour étudier la philosophie bouddhiste.
Hégémonie bouddhiste au Ladakh
Jusqu’au milieu du 15e siècle, le bouddhisme prospéra sans réelle opposition au Ladakh. La figure majeure de cette époque fut Changsems Shesrab Zangpo, l’un des principaux promoteurs de la secte Gelugpa (ou "Secte réformée"), qui fonda le monastère de Stakmo. Son disciple, Paldan Shesrab, établit le monastère de Thiksey, qui devint plus tard le monastère dominant de la secte dans le royaume.
Arrivée de l’Islam au Ladakh
En 1382, Mir Syed Ali Hamdani arriva au Ladakh et effectua les premières conversions à l’islam. On dit qu’il fit construire la mosquée de Shey. Plus tard, au 15e siècle, Shamsuddin Iraqi vint au Ladakh et convertit une petite partie de la population à la secte Noorbakshi de l’islam. Les premiers musulmans du Ladakh étaient des marchands du Cachemire qui s’installèrent et épousèrent des femmes ladakhies.
Conversion de l’ouest du Ladakh à l’islam
Vers le milieu du 16e siècle, la majeure partie de l’ouest du Ladakh se convertit à l’islam chiite.
L’invasion malheureuse du Baltistan et ses conséquences
Le roi Jamyang Namgyal (1595-1616) lança une invasion du Baltistan pour pacifier la région, mais fut capturé. Le conflit prit fin lorsqu’il épousa une princesse balti, Gyal Khatoon, qui vint au Ladakh avec une grande suite installée à Chuchot.
Staktsang Raspa et l’ascension de la secte Drukpa
Au 17e siècle, le maître tibétain Staktsang Raspa fut invité au Ladakh par le roi Singey Namgyal. Ce dernier lui offrit un soutien financier et politique. Staktsang Raspa fonda plusieurs monastères, dont le plus important, le monastère d’Hemis, en 1630, sur un ancien domaine royal.
La guerre Ladakh-Tibet-Mongols-Moghols et ses conséquences religieuses
Cette guerre complexe se termina par le traité de Tigmosgang, qui réduisit considérablement l’indépendance du Ladakh, notamment en matière religieuse. La défaite des forces ladakhies face aux envahisseurs tibéto-mongols et leur dépendance envers l’Empire moghol contraignirent le roi du Ladakh à se soumettre aux exigences des deux parties, entraînant des ingérences tibétaines dans la politique religieuse du royaume.
Les religions sous la période Dogra
Après la conquête du Ladakh par les Dogras, le pouvoir royal déclina, entraînant une baisse du soutien financier aux monastères. L’absence de mécénat et la fin des dotations aux religieux ralentirent leur expansion et, dans certains cas, provoquèrent leur déclin. Les grandes familles terriennes, issues de l’ancienne aristocratie ladakhie, continuèrent cependant à soutenir matériellement certains monastères en échange de privilèges religieux et sociaux.
Kushok Bakula et la renaissance du bouddhisme au Ladakh
Le 19e Kushok Bakula naquit en 1918 dans la famille royale de Matho. À l’âge de 3 ans, il fut reconnu comme la réincarnation d’Arhat Bakula, l’un des seize disciples directs du Bouddha. Il obtint en 1940 un diplôme de Geshes Lharampa du monastère de Loseling Drepung, puis retourna au Ladakh. Après l’indépendance de l’Inde, il devint une figure majeure du Ladakh, menant des réformes sociales telles que l’abolition des sacrifices d’animaux et la lutte contre le système des castes.

Le bouddhisme au Ladakh
Principales écoles
École Drugpa Kagyu
L'école Drugpa s'est implantée au Ladakh avec l'arrivée de Staktsang Raspa et son patronage ultérieur par le roi Singey Namgyal et ses successeurs. Malgré les affirmations de certains écrivains tibétains sur une discrimination envers l'école Gelugspa, les souverains ladakhis ont été relativement tolérants envers les autres écoles ainsi que les autres religions. La fondation du monastère d'Hémis en 1632, initialement un ermitage, et son émergence comme siège du pouvoir de Staktsang Rinpoche, le précepteur royal du royaume du Ladakh, ont inauguré une période de renaissance architecturale au Ladakh. Aujourd’hui encore, grâce à son importance passée, cette école a le plus grand nombre d’adeptes parmi les sectes bouddhistes.
École Gelugspa
Le Ladakh a connu l’essor de l’école Gelugspa à peu près en même temps que le Tibet, c'est-à-dire juste avant le milieu du XVe siècle. Changsems Shesrab Zangpo, le disciple principal de Tsongkhapa, fondateur de l'école, a été responsable de son implantation au Ladakh. Les monastères de cette école sont répartis dans toute la région, les principaux étant les monastères de Thiksey et Spituk. Rizong Sras Rinpoche est le seul Ladakhi à avoir accédé au trône de Galdan, la position la plus prestigieuse de cette école.
École Drigung Kagyu
L'école Drigung Kagyu, fondée en 1179 au Tibet, s'est répandue au Ladakh au siècle suivant. Mais la figure majeure de cette école au Ladakh a été Chosrje Danma Kunga Tagspa, qui a émergé au XVIe siècle. Les principaux monastères sont Lamayuru, Phyang et Shachukul.
École Sakya
L'école Sakya a un petit nombre d’adeptes au Ladakh. Son principal (et unique) monastère dans la région est le monastère de Matho.
École Nyingma
Le monastère de Takthok est le seul monastère appartenant à cette école au Ladakh.
Principaux sanctuaires
- Monastère de Hemis
- Monastère d'Alchi
- Monastère de Chemrey
- Monastère de Thiksey
- Monastère de Spituk
- Monastère de Lamayuru
Traditions
En cas de décès, des rituels sont effectués pendant un certain nombre de jours, selon les instructions d'un astrologue. Ensuite, le corps est incinéré lors de cérémonies élaborées qui suivent les traditions spécifiques de l’école bouddhiste à laquelle appartient la famille.
Cérémonies
Chaque maison bouddhiste possède généralement une chapelle, qui est le centre de rituels périodiques effectués par des moines locaux. Chaque école a ses propres rituels spécifiques. Un rituel commun est le Skangsol, qui se tient en automne pour marquer la récolte des cultures.
Festivals
Selon le calendrier bouddhiste, il y a des festivals monastiques tout au long de l'année. Le plus grand d’entre eux est le Hemis Tsechu, célébré au monastère de Hemis le 10e jour du 5e mois du calendrier bouddhiste. En dehors des festivals monastiques, la principale fête célébrée par les bouddhistes est le Losar, le Nouvel An ladakhi, qui a lieu pendant les trois premiers jours du 11e mois du calendrier bouddhiste. À Leh, les festivités se poursuivent jusqu’au Dosmochey, qui a lieu à la fin de l’hiver.

L'Islam au Ladakh
Principaux courants
Courant chiite
Le courant chiite de l'Islam est le plus répandu au Ladakh. Il constitue la majorité de la population du district de Kargil et est également bien représenté dans la vallée de la Nubra ainsi qu'à Chuchot, dans le Ladakh central.
Courant sunnite
Ce courant de l'Islam est présent dans les deux districts du Ladakh. La plupart de ses adeptes sont des descendants de commerçants cachemiris qui se sont mariés avec des Ladakhies et se sont installés au Ladakh. Leurs descendants sont appelés Arghon.
Courant Noorbakshi
Le courant Noorbakshi doit son origine au Ladakh à Mir Shamsuddin Iraqi, qui est venu dans la région au 15ᵉ siècle.
Principaux lieux de culte
- Jama Masjid, Leh
- SH Hamdan Masjid, Shey
- Imam Bargah, Chuchot Yokma
- Masjid e Jafria, Drass
